Une étude réalisée par Arri Faas, bénévole au Poisson sans bicyclette, en octobre 2024
Le Haut Conseil du Travail Social définit le travail social en ces termes : « ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. […] Il se fonde sur la relation à l’autre, dans sa singularité et le respect de sa dignité. Il vise à permettre l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits fondamentaux et à assurer la place de chacun dans la cité. […] Les principes de solidarité, de justice sociale, de laïcité, de responsabilité collective, et le respect des différences, des diversités, de l’altérité sont au cœur du travail social. […] ». (2017)
Cette définition, et son insistance notoire sur la nature relationnelle et plurielle du travail social, laissent imaginer un secteur en phase avec la recherche scientifique, particulièrement disposé à évoluer avec la société et les conditions de vie des personnes. Or, force est de constater que le secteur du travail social, en matière de sans-abrisme en tout cas, est théoriquement et pratiquement à la traîne. Les services sont saturés (et on ne peut bien sûr pas oublier la responsabilité gouvernementale dans l’assèchement des fonds publics à disposition du secteur), et très peu adaptés à la diversité des publics pourtant concernés par la précarité de logement. Certes, la place grandissante que prend dans le débat public le sujet des violences faites aux femmes pousse le travail social, entre autres, à s’adapter (bien que la problématique ne soit pas nouvelle), en ouvrant par exemple dans les villes des centres d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales. De tels dispositifs existaient bien avant #MeToo, et se sont multipliés depuis. Mais est-ce vraiment le seul aménagement auquel on peut penser ?
Dans cette étude, on se demandera si l’absence relative de femmes et de personnes LGBTQIA+ au sein des services d’aide sociale aux personnes sans-abri signifie vraiment un moindre besoin de ces personnes en la matière.
On regardera quels sont les facteurs de précarité matérielle, et s’ils sont exacerbés ou atténués selon le profil socio-économique.
On fera ensuite un petit tour d’horizon des services effectivement mis en place à destination de ce public, pour revenir à notre question de départ : est-ce que celui-ci présente moins de besoins ? A-t-on raison, en travail social, de ne s’y intéresser qu’en tant que public « minoritaire », et donc secondaire ?
Une moindre fréquentation signale-t-elle de moindres besoins ?
On entend souvent dire que les femmes (les personnes LGBTQIA+ sont très rarement citées) sont moins nombreuses dans la rue, qu’elles sont donc moins nombreuses à expérimenter cette forme extrême de précarité et de détresse, et qu’il est donc logique de ne pas adapter les services d’aide à un public largement minoritaire.
On pourrait d’abord dire que ces femmes, réduites à cette catégorie monolithique, n’ont pas la possibilité d’être reconnues, lorsque c’est leur cas, en tant que membres des communautés LGBTQIA+, elles aussi marginalisées sur la base de leur identité ou expression de genre, ou de leur orientation sexuelle. Dans le discours général, être une femme, c’est ne pas être un homme, et les autres facteurs de stigmatisation ne sont pas intégrés à cette équation, ce qui a malheureusement pour effet d’invisibiliser la réelle multiplicité des discriminations que peuvent subir les femmes et les personnes non conformes en termes de genre.
On peut aussi dire que cette réduction symbolique provient d’une vision démocratique de l’aide à la personne, selon laquelle les besoins les plus largement représentés sont ceux auxquels il faut répondre en priorité. Or, une autre vision est possible : l’équité (une chose adaptée à chacun·e, pour maximiser la satisfaction) plutôt que l’égalitarisme (la même chose pour chacun·e). Dans ce cadre-ci, on élargirait plutôt l’aide, et au besoin, on la compartimenterait (espaces dédiés) afin de permettre à toute personne d’en bénéficier dans les conditions qui conviennent le mieux à son profil.
Mais avant de développer cette vision équitable de l’aide sociale, on doit se demander si l’affirmation selon laquelle la moindre fréquentation des services est le signe indéniable d’un moindre besoin est vraie.
Sans-abri, sans chez-soi : de quoi parle-t-on ?
D’abord, qu’est-ce que le « sans-abrisme » ? Et donc, avant tout, qu’entend-on généralement par « sans-abri » ?
Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales indique qu’une personne sans-abri est celle qui « n’a pas ou […] plus de logement ». On entend parfois l’équivalent « sans domicile », ou « SDF », acronyme de « sans domicile fixe ». Ces appellations très largement utilisées ne font pourtant pas l’unanimité. En effet, l’abri au sens propre n’est qu’un « [l]ieu couvert protégeant […] des intempéries ou de quelque danger ». On peut abriter des plantes, des animaux et soi-même contre la pluie, le vent, la tempête, des températures excessivement froides ou chaudes.
Mais le lieu que l’on retrouve souvent après notre journée, celui où l’on dort la nuit et se réveille le matin, celui où l’on cuisine, mange, invite des ami·es, celui que l’on décore, pour lequel on fait des efforts afin qu’il nous plaise et nous semble confortable, ce lieu-là n’est pas qu’un abri. On parle volontiers, en français, de « chez-soi ».
C’est pourquoi le Syndicat des immenses (Individus dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences), collectif bruxellois de personnes concernées dans le passé ou encore aujourd’hui par la précarité matérielle, veut substituer le néologisme « sans-chez-soirisme » aux expressions courantes. Sous la plume de Laurent d’Ursel (2023), le syndicat constate que la plupart des personnes dites « sans-abri » en ont en fait un : « étant temporairement hébergées chez un proche, dans un squat ou une occupation, un asile de nuit, un hôtel ou encore une maison d’accueil. Seule une minorité d’entre elles dorment à l’extérieur, et sont donc à proprement parler sans abri. »
Yahyâ Hachem-Samii (2018), de l’association La Strada, ancien centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri désormais remplacé par Bruss’Help, indique ainsi que « le fait de vivre en rue n’est qu’un aspect du sans-abrisme qui recouvre une multitude de situations allant du logement insalubre au séjour temporaire dans une institution. Surtout, le sans-abrisme renvoie à ce dont il est l’opposé : avoir un chez-soi, un espace de vie dans lequel et à partir duquel l’individu peut exercer ses autres droits, à commencer par les plus fondamentaux : [s]e chauffer, se nourrir, se soigner, nouer des relations affectives, exercer des activités, s’informer, disposer de choses à soi, travailler, voter, voyager, etc. Autant d’éléments qui disparaissent lorsque la personne se retrouve à la rue ».
Pour plus de clarté dans la diversité des situations possibles, une typologie a été établie par la FEANTSA, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. La typologie ETHOS recense et classe les types de grande précarité matérielle. Celle-ci va de la survie dans la rue, soit l’espace de circulation gérée par les autorités publiques, à la vie en conditions de surpeuplement sévère, « défini comme excédent [sic] les normes nationales de densité en termes d’espace au sol ou de pièces utilisables ». Parmi les catégories, on retrouve notamment les personnes menacées de violences conjugales et domestiques (qui sont majoritairement des femmes et des enfants), des personnes en hébergement pour immigré·es, ou encore des personnes menacées d’expulsion.
En conséquence, une fois que l’on rassemble les personnes concernées par cette pluralité de situations, on réalise à quel point les dénombrements organisés dans différentes villes européennes, ayant pour but de compter une par une les personnes survivant en rue, est une sous-estimation très claire de l’exclusion dont souffrent beaucoup d’individus.
Femmes et personnes LGBTQIA+ sans chez-soi : de qui parle-t-on ?
Maintenant, qu’est-ce qu’une femme sans chez-soi ? Pourquoi, d’ailleurs, faire cette distinction ? Ne pourrait-on pas dire qu’une personne sans chez-soi est une personne sans chez-soi, indépendamment de son assignation de genre ?
Hafida Bachir (2018), de l’association bruxelloise Vie Féminine, explique l’importance du facteur genre comme suit : « [l]es indicateurs de pauvreté majoritairement utilisés donnent […] à penser qu’hommes et femmes connaissent les mêmes risques de pauvreté. Ces chiffres sont calculés sur des données d’enquête recueillies auprès des ménages. On part en fait du principe que dans les couples, les revenus sont partagés équitablement entre chaque membre du ménage. C’est pourquoi le DULBEA [Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, Femmes, précarités et pauvreté en Région bruxelloise, cahier thématique du Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2014] a proposé un autre indicateur, le « taux de dépendance financière », qui montre le pourcentage d’hommes et de femmes qui basculeraient sous le seuil de pauvreté si on ne prenait en compte que leurs revenus propres. On constate alors que sur les données belges, 33% des femmes et 11% des hommes dépendent financièrement d’une autre personne pour ne pas tomber dans la pauvreté. Enfin, les ménages qui sont particulièrement à risque de pauvreté sont les ménages monoparentaux, dont 86% ont à leur tête une femme. »
D’après elle, donc, le genre favorise un écart face au risque de pauvreté parmi la population belge, constat qui se retrouve en proportions similaires dans d’autres pays européens. Par exemple, selon un rapport de l’Institut National de la Statistique et Études Économiques, « […] les femmes vivent plus souvent que les hommes dans des conditions de pauvreté. […] Différents facteurs se cumulent pour générer cette disparité : les femmes sont plus souvent seules ou parents isolés ; elles sont moins souvent en emploi ; enfin, lorsqu’elles travaillent, elles perçoivent des salaires plus faibles. » (Jourdan, Timoteo, Rastit, 2010)
De la même manière, en Suisse, pourtant l’un des pays les plus riches du continent, cette statistique se vérifie. D’après un rapport Caritas datant de 2022, « […] les femmes sont plus touchées par la pauvreté, et également plus exposées à un risque de pauvreté, que les hommes. […] [L]e système de prévoyance étant lié au revenu, il est impossible pour les femmes qui effectuent une activité de soin non rémunérée de se constituer par elles-mêmes une prévoyance vieillesse correcte ».
Ces éléments permettent de mettre en avant l’aspect structurel de la pauvreté et du risque de pauvreté. Il ne s’agit pas d’un problème individuel, d’un manque de chance ou de motivation. Il ne s’agit pas non plus, bien sûr, d’une caractéristique féminine, d’une incapacité à se mettre à l’abri ou à s’organiser dans le temps. Il s’agit bel et bien des conséquences logiques de tout un système, soit un ensemble de circonstances structurelles qui génèrent ce genre de différence.
Il y a donc un déséquilibre clair et tangible entre l’exposition au risque de pauvreté des hommes et des femmes. L’ignorer est le signe, au mieux, d’un manque notoire d’information sur le sujet ou, au pire, d’une posture de déni face à un phénomène qui mériterait, au contraire, d’être visibilisé afin de pouvoir espérer le faire reculer autant que possible. D’accord.
Mais qu’en est-il des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance ? Qu’en est-il des personnes trans et non-binaires, qui par définition ne sont pas cisgenres1, et qui sont aussi touchées par la précarité ? Qu’en est-il des personnes dont l’orientation sexuelle est un facteur de risque dans leur famille et l’espace public ?
Et si l’on se penche maintenant spécifiquement sur les personnes qu’une expression anglophone qualifie de « gender non-conforming », que l’on pourrait traduire par « non conformes aux normes de genre » d’un point de vue de l’apparence ou des comportements, il y a des obstacles concrets à l’exercice des droits fondamentaux, et ce sans même prendre en compte leur statut d’habitation.
En effet, on peut évoquer le concept de « cis-hétérosexisme » pour dire que « le sexe est politique, hiérarchisé, normalisé. » Ce concept « réintègre la question du pouvoir, absente du concept d’homophobie, [et] permet d’articuler des stéréotypes sexistes et l’aversion envers les homosexuel·le·s. […] [Il] révèle les injustices commises à l’égard des personnes lgbt+, dans les interstices de leur vie quotidienne, dans les gestes et allusions subtiles du quotidien qui dévalorisent leur identité de genre et leur vie amoureuse et sexuelle. » (Gosselin, 2021). Grâce à lui, on comprend qu’une personne perçue comme non conforme aux normes de genre (et d’orientation sexuelle) sera très probablement victime, à un moment ou un autre de sa vie au moins, de discrimination cis-hétérosexiste de la part de son entourage, et de la société dans son ensemble. Cette discrimination, dans ses manifestations systémiques que l’on retrouve notamment au niveau des institutions, impacte directement et parfois lourdement la possibilité qu’ont les individus concernés d’exercer leurs droits fondamentaux, pourtant garantis en théorie.
Un rapport du Trevor Project, un organisme de prévention du suicide dans les communautés LGBTQIA+ aux États-Unis, souligne par exemple que « Les jeunes LGBTQ sont surreprésenté·e·s parmi les jeunes sans-abri et en situation d’instabilité de logement aux États-Unis. Ce risque élevé de sans-abrisme et d’instabilité du logement a des effets néfastes sur la santé mentale des jeunes LGBTQ. » (The Trevor Project, 2022, ma traduction).
Cette organisation déplore le fait que les personnes cumulant plusieurs facteurs de discrimination sont d’autant plus exposées au risque de grave précarité matérielle, y compris d’expérience du sans-abrisme. D’après le même rapport, les jeunes personnes concernées par la discrimination raciste sont surreprésentées parmi les jeunes LGBTQIA+ sans-abri ou à risque de ne plus bénéficier d’un logement stable. La page du rapport relève ainsi les résultats suivants : « Par rapport aux jeunes LGBTQ blancs, ceux qui étaient natifs/indigènes avaient plus du double de chances (aOR = 2,20) de connaître l’instabilité du logement ou l’absence de chez-soi, les jeunes LGBTQ noirs (aOR = 1,13), latinx (aOR = 1,24) et multiraciaux (aOR = 1,58) ayant également des chances significativement plus élevées. Plus précisément, les jeunes natifs/indigènes représentaient 1% des jeunes n’ayant pas connu d’instabilité de logement, mais 3% des jeunes ayant déclaré avoir connu une instabilité de logement dans le passé et 7% des jeunes actuellement sans-abri. Les jeunes multiraciaux sont également surreprésentés, puisqu’ils représentent 16% des jeunes qui n’ont pas connu d’instabilité de logement, 22% des jeunes qui ont déclaré une instabilité de logement antérieure et 24% des jeunes qui ont déclaré être actuellement sans-abri. »
Donc, au vu du risque de rejet social, et particulièrement familial, qui touche les personnes non conformes aux normes de genre, le risque de perdre son chez-soi sans avoir l’opportunité immédiate d’en trouver un autre est déjà exacerbé par rapport aux statistiques démographiques générales, et ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on considère des personnes discriminées selon plusieurs registres simultanément (sexisme, racisme, validisme, etc.).
Ce cumul de facteurs d’oppression, et les formes de discrimination qui en résultent, porte un nom : l’intersectionnalité. C’est Kimberlé Crenshaw, juriste et professeure à la UCLA School of Law et à la Columbia Law School qui la théorise formellement en 1989. Elle souhaite alors expliquer la double exclusion des femmes noires du mouvement féministe états-unien d’une part, dominé par les femmes blanches bourgeoises, et du mouvement pour les droits civiques d’autre part, dominé, lui, par les hommes noirs. « L’intersectionnalité est un concept nécessaire, quotidien, qui permet de comprendre, au-delà du cumul et du croisement, comment les identités des femmes sont elles-mêmes intersectionnelles ; comment la domination aujourd’hui se définit par des oppressions multiples. » (« Kimberlé Crenshaw, la Juriste Qui A Inventé “L’intersectionnalité” », 2019)
Donc, l’intersectionnalité est un concept qui permet de comprendre que les systèmes de domination sont pluriels, différents bien que tous tributaires de l’hétéro-cis-patriarcat, et qu’ils entrent en interaction en fonction de l’individu, pour impacter sa vie d’une manière « personnalisée ». Pour le formuler plus clairement, on pourrait s’appuyer sur une métaphore simple : prenons les couleurs dans l’eau. Si l’on verse de la peinture rouge dans de l’eau, celle-ci se teintera en rouge. Si on y ajoute ensuite du bleu, elle ne deviendra pas bleue, mais violette, parce que selon le tableau chromatique et toutes nos expériences d’enfants avec la pâte à modeler, le rouge mélangé au bleu, ça donne du violet. L’intersectionnalité n’est finalement qu’une autre manière de parler d’effets de mélange. Comme les couleurs, les discriminations dont peuvent être victimes certains groupes dans la population, peuvent être « actives » seules, ou se mêler à d’autres, donnant alors un cocktail particulier, une nouvelle forme d’oppression systémique.
Et de la même manière qu’il est impossible, une fois mélangées, d’isoler la couleur bleue de la couleur rouge, il est impossible d’isoler une forme de discrimination d’une autre, puisqu’elles ont formé un type de discrimination nouveau.
C’est sur la base de cette réflexion que l’universitaire américaine Moya Bailey a inventé le terme et concept de « misogynoire », pour qualifier l’oppression spécifique que subissent les femmes noires ou perçues comme telles. (Mérentié, 2023).
Jusqu’ici, on a vu que le sans-abrisme, ou sans-chez-soirisme pour plus de précision, était un phénomène complexe qui recouvrait bien plus de réalités que celles des personnes survivant directement en rue. On a abordé sans encore trop de détails ce que le facteur genre induisait en termes de risques dans la vie des personnes. Enfin, on a commencé à évoquer le cas des personnes LGBTQIA+, marginalisées de par leur identité de genre et/ou leur orientation sexuelle et/ou leur expression de genre non conformes, ainsi que des facteurs liés à d’autres types d’oppression systémique qui pouvaient rentrer en interaction et créer un nouveau type d’oppression.
Tout ceci doit amener à reconnaître qu’il est impossible de parler de précarité matérielle et de sans-chez-soirisme sans prendre en compte un certain nombre de facteurs socio-économiques qui sont déterminants pour comprendre l’ampleur et la complexité du phénomène.
Mais d’autres questions se posent encore : les femmes cisgenres, les personnes transgenres et non-binaires sont-iels soumis·es à un régime particulier quant à leur présence dans l’espace public ? Quel est le risque pour elleux d’être confronté·es à une forme ou une autre de violence ?
Et deuxièmement, quels sont les risques, pour cette population, de se retrouver un jour sans chez-soi ?
Les femmes (cis) face à l’espace public
D’abord, on peut se concentrer sur le groupe des femmes, et leur droit d’accès et de circulation dans l’espace public. Les femmes sans-abri étant des femmes, elles partagent avec celles qui ont un chez-soi la même problématique : l’espace public est un espace d’insécurité pour elles (Lieber, 2008). Certes, l’égalité des genres dans l’espace public est censée avoir été entérinée depuis longtemps, et ne fait pas réellement débat aujourd’hui. Oui, les femmes circulent dans les rues, et peuvent même s’y promener, sans destination particulière, pour profiter des infrastructures mises à leur disposition, ou simplement du beau temps. Elles peuvent s’y déplacer à pied, à vélo, en voiture, en trottinette, et tout autre moyen de transport qui leur est agréable. Il n’y a aucune forme de restriction légale à leur libre occupation de l’espace public.
Et pourtant.
Les études de genre sont formelles : l’accès et la capacité de jouissance des espaces publics par les individus n’est pas égalitaire, ni équitable. Le harcèlement et la violence physique dans la rue sont des risques à prendre, apparemment, lorsqu’on est perçu·e comme une femme à l’extérieur de son domicile. Et, alors que ce fait semble plus qu’amplement documenté depuis une trentaine d’années au moins, la réponse des pouvoirs publics sur la question reste globalement la même : le risque de l’agression n’est « ni discuté, ni remis en question, pas plus qu’il n’est considéré comme relevant de l’intervention publique : c’est aux femmes de faire attention » (Lieber, 2002, p.44).
Les personnes LGBTQIA+ et l’espace public
Concernant les personnes transgenres2, une étude qualitative belge, menée en 2020 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, informe sur la nature spécifique des violences transphobes subies dans l’espace public. Ainsi, on compte 45% de personnes déclarant avoir été confrontées à des injures en rue ou dans un autre lieu public durant l’année écoulée. La fréquence des insultes est quant à elle très importante, puisque sur les 12 derniers mois avant l’enquête, 61% des personnes interrogées disent en avoir subies plusieurs fois. La teneur des insultes et des invectives est particulièrement violente : « [o]utre le fait de se faire traiter de pute, les répondant·es signalent d’autres allusions à la prostitution, telles que “Hoeveel is ‘t?”3 ou “Elle fait le trottoir”. Les autres remarques inappropriées à caractère sexuel sont par exemple : “T’as des bons seins”, “Ta tête est moche mais tu serais belle en levrette” ou “Suce ma bite”. De plus, les répondant·es signalent aussi de nombreuses allusions aux violences sexuelles. “J’ai envie de te violer”, ou “Tu veux voir mon bonbon ? (Avec la main au paquet)”. Ou encore : “Ma bite va te faire goûter ce qui est bon”. Les références à la mère semblent également être de mise : “Je vais niquer ta mère”. […] Par ailleurs, les insultes qui font référence à une orientation sexuelle supposée sont aussi monnaie courante, comme par exemple “homo”, “bruinwerker”, “faggot”4, “lesbo”5, “sale lesbienne”, “tapette”, “PD”, “manwijf”6, etc.[…] Pour terminer, il y a aussi les menaces de mort directes, telles que “Ik ga een gat in je kop schieten”7, ou “Va crever sale monstre”. »
Enfin, malheureusement, on constate que « [l]e harcèlement et la violence en rue et dans d’autres lieux publics ne se limitent pas toujours aux insultes. Au cours de l’année écoulée [avant l’enquête], 15% des répondant-e-s du groupe transgenre ont été suivi-e-s, 9% ont subi des attouchements intimes, 6% ont été victimes de vandalisme, 5% ont reçu des coups, 3% ont été victimes d’un(e tentative de) vol avec violence, 1% d’un viol. 1% ont été menacé-e-s au moyen d’une arme. 37% des répondant-e-s ont été confronté-e-s à au moins l’une de ces formes de violence au cours des 12 mois qui ont précédé l’enquête. » (Enquête # YouToo ? , 2020)
Les insultes et actes homophobes sont par ailleurs à la hausse, comme on peut le constater à partir des données du Ministère français de l’Intérieur. En effet, les services de police et de gendarmerie ont enregistré, en 2022, un total de 2417 crimes et délits anti-LGBTQIA+ dans le pays, soit 2,4 fois plus qu’en 2016. (Carpentier, 2023)
« Les infractions les plus souvent citées sont majoritairement verbales : dans 38% des cas, il s’agit d’injures et pour 20%, de menaces, les deux faits les plus fréquemment cités. Si l’on ajoute les 22% de cas de violences physiques aux 2% de viols et agressions sexuelles, 24% des actes homophobes marquent physiquement les victimes. » (Maurin, 2023)
Il faut ajouter à ça une différence majeure entre les risques de violence encourus par les femmes cis hétérosexuelles et ceux encourus par les membres de la communautés LGBTQIA+ : ces dernier·ères sont plus susceptibles de subir des attaques (verbales ou physiques) dans l’espace public, et c’est le cas pour les deux tiers des agressions (Maurin, 2023), tandis que la violence envers les femmes cis se déroule très majoritairement dans l’espace privé, par des personnes de l’entourage de la victime (mutilations génitales, viols, violences domestiques, etc.). Pour ce qui est des viols et tentatives de viols, « [d]ans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits. » (Dagorn, 2021)
On peut donc dire que l’insécurité chronique pour les femmes cisgenres et les personnes transgenres est un problème récurrent, qui dépend de la façon dont est perçue la victime (femme cis, personne trans, homosexuelle, etc.) largement documenté par les sciences sociales depuis des années, et qui dépasse en ampleur et en intensité l’insécurité des hommes cis hétérosexuels ou perçus comme tels dans l’espace public.
Garder son logement en tant que femme et/ou LGBTQIA+
Maintenant, pour ce qui est du risque de perdre son chez-soi à un moment ou un autre du parcours de vie, il semble logique de s’attendre à ce qu’il soit, là encore, exacerbé pour cette population.
Malheureusement, comme le relève la Fédération des acteurs de la solidarité, « [e]n Europe […], il n’existe aucun chiffre officiel sur la proportion de personnes LGBTIQ [sic] parmi les personnes sans-abri, qu’elles soient dans ou hors de l’hébergement. Rares sont les pays où des réseaux associatifs accompagnent les personnes LGBTIQ [sic] sans abri. » (Fédération des Acteurs de la Solidarité, 2020) Le Canada et les États-Unis bénéficient pour le moment d’une meilleure base de données statistiques sur le sujet. D’après un article du média Alter Échos, « [dans ces deux pays], on estime que 20% à 40% des jeunes sans abri seraient LGBTQIA+. En Belgique, pas de chiffres, mais une chose est sûre : les personnes LGBT, quel que soit leur âge, sont plus à risque de se retrouver en situation de (grande) précarité. » (Mormont, 2023)
Pourquoi cela ?
On peut faire le lien entre oppression systémique et risque de perdre/ne pas trouver immédiatement un lieu d’habitation décent. « De nombreux experts croient que la discrimination est la cause de l’itinérance8 des personnes 2SLGBTQIA+9. Elles y sont d’abord confrontées à la maison puis par la société lorsqu’elles essaient, par exemple, de trouver un logement convenable. » (Elver, 2024)
On trouve tout de même quelques chiffres européens corroborant ces observations dans l’enquête française sur la discrimination dans l’accès au logement, réalisée en 2017 par le Défenseur des Droits. Celle-ci relève notamment que, parmi les personnes en difficulté financière bénéficiant d’une aide d’État, 32,4% cherchent à se loger sur le marché locatif. Celles qui ne perçoivent rien sont 30,9% dans ce cas. En fait, plus la vulnérabilité économique est grande, plus il est difficile de trouver de quoi se loger en tant que locataire (le marché acquisitif étant évidemment complètement exclu).
Le paramètre hommes/femmes, lui, donne à voir que ces dernières sont légèrement plus concernées par la recherche d’un logement à louer (24,5% contre 23,4%). Donc, les femmes et les personnes LGBTQIA+ sont plus souvent précarisées que les autres, et donc proportionnellement plus confrontées à la recherche de logement.
Les statistiques démontrent aussi une relation de causalité entre le lien à l’immigration et la recherche de logement. Ainsi, les personnes nées françaises sont 22,6% en recherche de logement, contre 37% pour les immigré·es. Enfin, les répondant·es pensant être perçu·es comme noir·es sont de loin les plus en danger d’un point de vue du logement (49,7% en recherche), juste avant celleux se pensant perçu·es comme arabes (43%). L’enquête conclut alors que « […] être parent isolé·e, être handicapé·e, être immigré·e, ou encore être en situation de précarité financière sans pouvoir être aidé·e par son entourage, sont autant de facteurs associés à une durée de recherche plus longue. L’accès au logement, plus difficile pour ces différents groupes sociaux, se traduit dans l’enquête par un temps de recherche plus long et des recherches infructueuses plus fréquentes », ce qui explique le taux de recherche plus élevé.
Crise du logement et pénurie d’alternatives sociales
Ce qu’on appelle communément la crise du logement est un problème généralisé à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne (UE). À Bruxelles (qui ne fait pas exception), deux facteurs principaux participent à cette situation : « d’une part l’appauvrissement croissant de la population : aujourd’hui, un tiers (33%) de la population vit sous le seuil de pauvreté », et d’autre part « l’augmentation du coût du logement. En effet, depuis le début des années 2000, l’évolution des revenus stagne comparée à l’augmentation continue du coût du logement » (Dupont, 2022).
À l’échelle de l’UE aussi, on observe la hausse souvent drastique des prix du logement depuis des années déjà. Entre 2010 et 2022, un rapport statistique européen en établit l’augmentation, aussi bien sur le marché acquisitif (achat) que locatif, de 47% et 18% respectivement. (Eurostat, 2023)
Le simple fait de se loger dignement est donc globalement de moins en moins accessible à la population.
Or, l’offre de logement social souffre d’un effet de saturation chronique, dans la plupart des pays européens. En effet, le parc locatif social est déficitaire, c’est-à-dire qu’il ne produit pas assez de logements comparé à la demande qui ne cesse d’augmenter pour toutes les raisons qui ont été mentionnées. Alors que le logement social est censé pallier autant que possible l’insuffisance du parc locatif privé (et du manque d’accessibilité à la propriété immobilière), la pénurie est, là aussi, significative. Selon Alice Romainville et Sarah De Laet, « [a]lors que ses listes d’attente comptent, dans les trois régions belges, des dizaines de milliers de ménages, le logement social fait aujourd’hui figure de parent pauvre de la politique de l’habitat. Il représente seulement 6% des logements, et l’évolution du stock est pratiquement au point mort. » (Romainville & De Laet, 2023)
Dans ce contexte, la demande de logement social explose, tandis que l’offre n’est pas actuellement, ni dans un futur proche, capable de l’absorber.
Or, ce sont les familles monoparentales (qui, on l’a vu, sont en forte majorité constituées d’une femme avec ses enfants) et les personnes immigrées qui sont le plus fréquemment poussées, par manque de moyens, vers le parc locatif social (« respectivement 45% et 46%, contre 25% en moyenne »). « Le logement social constitue en effet la principale option de logement pour les familles monoparentales, parfois la seule, face à des loyers et des niveaux de garanties demandés qui leur sont bien souvent inaccessibles dans le logement privé. Ce phénomène s’est accentué depuis la fin des années 1990, la part des familles monoparentales étant devenue particulièrement importante parmi les locataires HLM10 (37% en 2013, contre 15% pour des familles composées de deux parents). » (Défenseur des Droits, 2017)
Jusqu’ici, on a établi une définition du sans-chez-soirisme et exploré sa complexité, qui va bien au-delà de la survie sur un trottoir ou sous un pont. On a développé l’impact du genre sur la précarité et le risque de précarité, en explorant le concept d’intersectionnalité qui constitue une clé de compréhension très utile pour lire efficacement le lien entre oppression systémique et détresse matérielle. On s’est ensuite intéressé au rapport des femmes cis et personnes LGBTQIA+ à l’espace public, surtout du point de vue de leur sécurité, ce qui a permis de mettre en lumière le fait qu’iels risquent de subir une violence verbale et physique qui dépend de la façon dont on les perçoit, et qui est comparativement plus forte et récurrente que celle que risquent de subir les hommes cis hétérosexuels et perçus comme tels. On s’est enfin concentré sur le risque de perdre ou de ne pas trouver de logement décent quand on subit une ou plusieurs formes d’oppression systémique (qui est donc plus important que la moyenne) et sur la crise du logement et la pénurie de logements sociaux qui accentue cette problématique pour la population concernée.
On peut donc pour l’instant conclure que, en premier lieu, le sans-chez-soirisme est un phénomène sociétal complexe qui recouvre une multitude de situations et qui touche plus durement des populations fragilisées par l’oppression systémique (sexiste, raciste, etc.).
Deuxièmement, l’espace public n’est pas neutre, et n’offre pas les mêmes conditions d’accès à tout le monde, les personnes concernées par l’oppression cis-sexiste y étant moins en sécurité que les autres. Ceci peut nous amener à penser que les femmes et les personnes LGBTQIA+ qui doivent survivre en rue sont plus en danger que les hommes dans la même situation.
Les constats ci-dessus écartent définitivement l’hypothèse selon laquelle les besoins des femmes et des personnes LGBTQIA+ sans chez-soi seraient moindres. Non, ces publics ne sont pas moins confrontés à la précarité, la violence, l’oppression. Au contraire.
Par conséquent, on peut affirmer que leur moindre fréquentation des services d’aide n’est pas le signe d’une absence de besoins, mais de l’inadéquation entre ces derniers et les services proposés. Mais pour aller plus loin, il faut s’intéresser plus pratiquement à ce qui est mis en place, en termes de ce qu’on appelle donc des « services d’aide », par les associations du secteur.
Femmes et personnes LGBTQIA+ sans chez-soi, ce que les associations mettent en place
Puisqu’il n’y a aucune étude à l’échelle européenne sur les réponses institutionnelles et associatives face au sans-abrisme, on se concentrera ici sur les cas de la Belgique et de la France. La culture étant largement partagée, on peut s’attendre aux mêmes types d’enjeu et aux mêmes formes de discrimination systémique de part et d’autre de la frontière. Alors, en Belgique et en France, comment la société civile s’organise-t-elle au travers d’associations caritatives (ASBL en Belgique, dites « loi 1901 » en France) pour intervenir auprès des femmes et personnes LGBTQIA+ sans-chez-soi ?
La France compte un nombre important d’associations et de fondations, dont on peut citer les plus connues : Fondation Abbé Pierre, Le Secours Catholique – Caritas France, Médecins du Monde, la Croix-Rouge Française, Emmaüs. En Belgique, le secteur associatif est très fragmenté, notamment en fonction des régions et communautés linguistiques qui cohabitent dans le pays, mais on peut citer les plus connues du public bruxellois : Les Petits Rien, L’Ilot, Infirmiers de Rue. Parmi toutes les associations citées ci-dessus, aucune n’a pour objet premier et unique d’intervenir auprès des femmes et personnes LGBTQIA+ sans-chez-soi. La plupart ont, un certain temps après leur création, aménagé leurs statuts et/ou leurs missions dans le sens d’une meilleure inclusivité de la diversité des profils que leur travail les amenait à rencontrer. Par exemple, L’Ilot a été la toute première association à ouvrir, en septembre 2023, un centre d’accueil de jour exclusivement réservé aux femmes, et géré exclusivement par des travailleuses. Sur le site Internet de l’association, on peut lire que cette initiative constitue justement « l’aboutissement d’un travail de diagnostic posant de multiples constats réalisés depuis plusieurs années au sein de notre association sur le manque de prise en compte du sans-abrisme au féminin. » (L’Ilot, 2024)
L’association DoucheFLUX a quant à elle aménagé une journée d’accueil de jour réservée au public féminin (incluant de manière explicite les femmes trans), le mercredi de chaque semaine, avec un horaire de fermeture légèrement plus souple. Autrefois appelée « 100% femmes », cette journée a été renommée « 100% femmxs » puis « Horizon Fxmmes » plus récemment.
Plusieurs maisons d’accueil existent également en Région Bruxelles-Capitale, comme celle gérée par Talita asbl, dans le centre de la ville, qui veut offrir « un hébergement et un accompagnement à toute femme majeure avec ou sans enfants qui, suite à différents facteurs, se retrouve temporairement sans logement et n’est plus en mesure de vivre de manière autonome »11.
Le New Samusocial a de son côté ouvert le centre Louiza, « accueillant exclusivement des femmes isolées et quelques mamans célibataires avec leurs enfants »12.
Côté français, la Région Île de France s’était targuée, en fin d’année 2020, d’ouvrir « une première Maison régionale des femmes réservée à ces femmes vulnérables »13, suivie de deux autres.
Mais quelles sont concrètement les actions que se proposent de réaliser ces associations pour adapter leur offre de services aux femmes et personnes LGBTQIA+ sans-chez-soi ?
D’abord, il faut rappeler que même si ce travail veut prendre en compte à la fois les femmes et les personnes LGBTQIA+, soit toutes les personnes victimes d’oppression cis-hétérosexiste, réduites à leur genre ou leur orientation sexuelle et déshumanisées en conséquence, il est clair que les associations de soutien aux personnes sans-abri, si elles ont su adopter quelques changements dans leur communication publique et/ou leur offre de services, ne l’ont fait que de manière ciblée sur les femmes, envisagées par défaut comme étant hétérosexuelles et cisgenres.
Pour preuve, on peut commencer par regarder les sites Internet des quelques associations citées plus haut. La plupart d’entre elles ont adopté un discours plus inclusif, mettant en lumière le fait que les femmes sans-abri ne sont pas inexistantes, bien qu’invisibles, mais force est de constater qu’aucune ne parle spécifiquement des autres personnes concernées par le cis-hétérosexisme, pourtant nombreuses et hautement touchées par le risque de se retrouver un jour sans domicile.
Le discours « inclusif » de ces associations tourne donc presque exclusivement autour des femmes. La révolution en la matière est que le secteur du sans-abrisme se mettait enfin à considérer la pluralité de facteurs pouvant mener à un parcours de rue, ce qui, pour les femmes, voulait dire prendre en compte les violences sexistes et sexuelles, à commencer par les violences domestiques dont elles sont souvent victimes et qui accroissent le risque de précarité de logement, comme le soulignent la FEANTSA et sa typologie ETHOS déjà citée.
L’ouverture du centre Circé, le centre de jour pour les femmes de l’association bruxelloise L’Ilot, se base d’ailleurs ostensiblement sur l’apport théorique d’une recherche-action menée en interne depuis 2021 sur les femmes sans-chez-soi. Un rapport de recherche est paru sur leur site, dont l’intitulé annonce la couleur : « sans-abrisme au féminin : sortir de l’invisibilité ». Il y est question de l’inextricable lien entre sans-abrisme « au féminin » et violences intrafamiliales.
D’après cette étude, toutes les analyses, nationales et internationales, convergent vers le même point : les femmes sans-abri ont, pour l’écrasante majorité, subi une forme de violence fondée sur le genre (L’Ilot, 2022). Il est donc question d’intégrer cette donnée à la prise en charge de ces femmes, aussi bien en termes d’outils novateurs (espaces dédiés à recueillir leur parole sur les violences sexistes et sexuelles subies, par exemple) que de fonctionnement associatif (créer des centres gérés exclusivement par des femmes, développer la pair-aidance, etc.).
Pas d’étude comparable pour le public LGBTQIA+. Pas de recommandations claires, et donc pas d’horizon permettant d’envisager concrètement leur inclusion dans les programmes associatifs. Alors que ce n’est qu’en répondant à leurs problèmes spécifiques que l’on peut espérer trouver des solutions qui leur conviennent réellement.
La « violence fondée sur le genre » dont parlent les associations les plus féministes ne semble pas inclure (du moins pas explicitement) toutes ses victimes. Sous cette expression se dessine plutôt les contours d’une binarité toujours bien en place, où il y a les hommes d’un côté et les femmes de l’autre (plutôt en haut et en bas d’une hiérarchie à deux étages), ceux qui gagnent et celles qui perdent, ceux qui perdent et celles qui perdent encore plus. Rien ne permet de complexifier l’échelle hiérarchique, qui recouvre en réalité un plus grand nombre d’étages, comportant eux-mêmes des entre-sols et une porte condamnée déguisée en ascenseur. Et à ce stade, il faut ajouter qu’en plus, la violence fondée sur le genre frappe en intensité variable, certes, mais aussi différemment selon le contexte (les femmes sont plus à risque dans l’espace privé, entourées de gens qu’elles connaissent, les personnes trans et les hommes ostensiblement gays sont plus en danger dans la rue et les lieux publics).
Cette connaissance approfondie du sujet n’est pas reflétée par le discours des associations dites plus inclusives.
Enfin, les initiatives associatives, plus ou moins explicitement féministes, dans le secteur du sans-abrisme sont aussi relativement claires quant au public qu’elles visent (et donc aux publics qu’elles ne visent pas) : BruZelle, association bruxelloise souhaitant combattre la précarité menstruelle, a probablement choisi son nom pour jouer entre Bruxelles, le nom de la ville où elle est active, et le pronom « elle », pendant de « il », en français, dévoyé depuis des siècles par l’Académie Française selon qui le masculin l’emporte toujours sur le féminin. On voit évidemment la portée contestataire et ostentatoirement militante d’un tel nom d’association. Mais il exclut de fait toute personne menstruée n’utilisant pas ce pronom pour elle-même pour différentes raisons. Cela dit, force est de reconnaître que le site Internet14, intégralement en langage inclusif, ne parle jamais de femmes, mais bien de personnes menstruées. C’est encore le meilleur exemple d’une volonté réussie de ne pas invisibiliser les personnes trans, du moins dans le discours.
Le centre Circé de L’Ilot est un exemple qui frappe par son caractère excluant. Sur la page descriptive du projet, il n’est question que des femmes, tout est conjugué au féminin, et le nom même du centre a été choisi par l’équipe en vertu du fait qu’il fait référence à « l’émancipation féminine dans la mythologie grecque ». La métaphore émancipatoire est ensuite filée à partir du mythe en question, renforçant dans la foulée la binarité sur laquelle s’axe le discours de l’association : « Son mythe a été récupéré par le patriarcat pour justifier la marginalisation et la punition de femmes jugées trop libres, trop indépendantes et trop savantes par rapport aux hommes. C’est une sorcière et derrière cette figure se cache toujours la même idée : celle d’une femme ayant acquis plus de pouvoir que ce que la société ne tolère pour celles qui ont longtemps été considérées comme appartenant au « deuxième sexe ». » Certes, le nom Circé fait aussi office d’acronyme (« communautaire inclusif révolutionnaire créateur d’émancipation féminine »), et inclut donc la question de l’inclusivité, mais finit malgré tout par réaffirmer son action « féminine » tournée vers l’émancipation « féminine ».
Même réflexion pour le centre Louiza du New Samusocial, qui porte un prénom féminin et se présente comme un « centre pour femmes ». Le nom n’est pas anodin et a été choisi à la suite du meurtre d’une femme, employée au Samusocial, par son ex-mari15. La démarche dénonce ainsi les violences intra-familiales, et la récurrence des féminicides qui en découlent. Sur cette même page du site Internet, on peut donc lire que « [p]ar une action symbolique, nous avons tenu à acter l’engagement du Samusocial dans la lutte contre les violences faites aux femmes en baptisant notre centre d’accueil pour femmes isolées LOUIZA » et, plus loin : « [l]a mission du centre LOUIZA est de fournir une aide immédiate aux hébergées, de les protéger, les rassurer, les aider à (se) reconstruire un avenir. Celles-ci constituent un public particulièrement vulnérable. Dans un souci de sécurité et de réappropriation de soi, il est primordial de mettre à leur disposition des centres d’accueil non-mixte. » Ici, on évoque même la « non-mixité » des locaux, qui rappelle le « 100% femmes » de l’association DoucheFLUX ou l’équipe « 100% féminine » du centre Circé.
Bien entendu, il n’est pas question de regretter ces initiatives. La reconnaissance du facteur genre et de son influence déterminante sur le parcours et la souffrance des femmes, notamment à la rue, est un progrès indéniable qui doit être salué et encouragé.
Il faut reconnaître l’importance des actions récemment menées pour venir en aide aux femmes. Ces changements étaient nécessaires et continuent de l’être aujourd’hui. Rien ne devrait décourager les associations de se former et s’adapter aux besoins de leurs publics, diversifiés et pluriels.
Justement. Les associations de soutien aux personnes sans-abri doivent pouvoir supporter et, surtout, se servir de la critique pour améliorer leur action, renforcer leur engagement et adapter toujours plus leur approche et leur fonctionnement. Il ne suffit pas de changer quelques mots sur un site Internet, ou proposer une après-midi hebdomadaire réservée aux femmes. Il faut réfléchir en continu, avec le monde qui nous entoure, avec la recherche et les pouvoirs publics, et surtout avec les personnes concernées, pour ne pas passer complètement à côté des problématiques réelles auxquelles les publics sont confrontés, et se contenter d’une performance stérile de réflexivité.
Déni de réalité et problématique de non-recours
Si les besoins des femmes et des personnes LGBTQIA+ sans chez-soi sont aussi réels que nombreux, et que quelques associations ont déjà prouvé leur volonté d’adapter leur travail à cette réalité, il paraît évident que la majeure partie d’entre elles et des discours qu’elles produisent continuent de nier, entièrement ou partiellement, la nécessité de questionner en profondeur la portée de leurs pratiques actuelles, et les pistes d’aménagement concret pour améliorer leurs possibilités de prise en charge dans le secteur du sans-abrisme.
Cette réticence, que l’on pourrait presque qualifier de déni de réalité, peut s’expliquer du fait de la majorité observable d’hommes vivant littéralement à la rue (le type de sans-chez-soirisme le plus visible), vérifiée par toutes les études, dans tous les pays qui s’y sont intéressés. Pourquoi changer alors que la demande n’a pas l’air d’évoluer ? Il y a toujours beaucoup plus d’hommes adultes que de n’importe quel autre profil dans la rue, on ne va pas tout bousculer pour quelques personnes.
C’est seulement en prenant en compte le sans-abrisme dans son sens le plus large (le sans-chez-soirisme), avec les situations d’errance entre appartements de proches, les personnes coincées chez elle avec un membre du ménage violent, etc. que l’on peut comprendre qu’une réorganisation du travail social est bel et bien nécessaire.
Si l’intérêt des professionnel·les est si récent et si marginal, on peut faire l’hypothèse que c’est en partie à cause du manque de précision dans les termes (sans-abrisme, concept trop strict et réducteur, préféré à sans-chez-soirisme, récent et encore anonyme) censés décrire la problématique. Car en effet, il faut bien reconnaître que si l’on ne s’intéresse qu’au sans-abrisme le plus littéral, il n’y a (presque) que des hommes cis adultes. Tout réside dans le presque. Tout réside dans l’élargissement de ce concept (le sans-abrisme) qui met des œillères là où précisément il faudrait ouvrir grand les yeux.
De fait, l’état actuel de la prise en charge des femmes et des personnes LGBTQIA+ n’est pas satisfaisant à plusieurs égards.
D’un point de vue pratique, il est difficile d’avancer des certitudes et des faits, car la recherche ne s’est pas encore assez emparée de ce sujet. Mais on peut, sur la base de tout ce qui a déjà été évoqué, imaginer que le lien de causalité doit être inversé : comme avancé plus haut, si les services d’aide sont principalement fréquentés par des hommes, ce n’est pas que les femmes et les personnes LGBTQIA+ n’en ont aucun besoin, mais plutôt que ces services ne leur sont pas réellement destinés, ce qui produit un effet dissuasif. En d’autres termes, si rien ne permet d’accueillir un public spécifique, alors ce dernier ne viendra pas. Un·e parent·e, voulant emmener ses enfants à la piscine, en cherchera une qui propose une infrastructure adaptée (des bassins peu profonds, des jeux comme des fontaines ou des toboggans, etc.). Dans sa recherche de logement, une personne se déplaçant en fauteuil roulant cherchera un endroit idéalement sans escaliers ou au rez-de-chaussée, du moins avec un ascenseur assez spacieux, une salle de bain aménagée pour une meilleure accessibilité, etc. Si le personnel de la piscine, dans le premier exemple, ne voit que très rarement des enfants dans ses bassins, il serait naïf de penser que c’est parce que les enfants ne vont jamais à la piscine, ou bien qu’il n’y a tout simplement pas d’enfants dans cette ville ou ce quartier. Dans le deuxième exemple, puisque l’écrasante majorité des logements urbains ne sont malheureusement pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, il y en a peu parmi elles qui font des visites d’appartements en dehors de circuits immobiliers dédiés, ce qui les invisibilise sur les marchés immobilier et locatif « généraux ». Est-ce que ça veut dire pour autant qu’il n’y a pas de personne dans ce cas à vouloir se loger ? Bien sûr que non. Affirmer qu’il y a peu ou pas de femmes et de personnes LGBTQIA+ sans chez-soi sans chercher à les accueillir nulle part, c’est contradictoire.
Par contre, on peut discuter de l’aspect éthique du retard des associations en matière d’adaptation structurelle. Ceci s’apparente à une exclusion passive d’une bonne partie des victimes de violences fondées sur le genre et, de ce fait, concerné·es par l’oppression systémique que les associations les plus avancées sur la question dénoncent. Alors, l’invisibilisation et le silence entourant depuis toujours la question du « sans-abrisme au féminin » se concentrent et se referment sur les personnes non conformes en termes de genre et/ou de sexualité, qui dévient de la norme binaire sur laquelle reposent les fondements du patriarcat.
Leur exclusion comporte un aspect particulièrement pervers, puisqu’il s’agit de dire que c’est de leur faute si les associations n’aménagent pas leur travail en fonction de leurs besoins, puisqu’iels ne les manifestent pas, ou pas assez.
Alors qu’en réalité, il s’agit en fin de compte d’une problématique dite de non-recours. Cette notion « renvoie à toute personne qui – en tout état de cause – ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre. » (Warin, 2010) Autrement dit, elle fait référence au fait qu’une personne pourtant éligible à une aide publique n’en fait pas la demande, ou abandonne en cours de route. Les travaux sur ce phénomène cherchent à identifier et analyser les différentes raisons qui en sont à l’origine. Warin reprend la typologie établie par l’Observatoire des non-recours aux droits et services, où les trois principales formes de non-recours sont :
- « La non connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue,
- La non demande, quand elle est connue mais pas demandée,
- La non réception, lorsqu’elle est connue, demandée mais pas obtenue. »
La question devrait aussi être posée dans ces termes concernant le secteur du sans-abrisme.
D’abord, il serait naïf de croire que les associations, même les plus connues dans une ville donnée, touchent la totalité du public qu’elles ciblent.
Dans le cas des femmes et des personnes LGBTQIA+ sans chez-soi, il doit donc y en avoir qui n’ont pas connaissance de l’existence d’équipes disposées à les prendre en charge. Si cela était confirmé par la recherche, il faudrait concevoir des moyens concrets de minimiser le problème de non-réception de l’information.
Ensuite, il y a sans doute des personnes qui connaissent le travail des associations, voire en ont déjà bénéficié, mais renoncent ou refusent de continuer à le faire. Or, puisque d’une part on a vu que ce ne sont pas les besoins qui manquent dans la population féminine et LGBTQIA+, et que d’autre part les recherches sur leurs besoins spécifiques sont extrêmement récentes et ne font pas encore l’objet d’un réel débat public, on peut légitimement conclure que l’un des facteurs de ce non-recours peut être que les services d’aide ne leur sont, en fait, pas destinés (ou si peu), puisqu’aucune démarche de personnalisation n’a été réalisée.
En effet, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que des démarches professionnelles d’aide sociale, pensées par et pour des hommes, puissent convenir à tout le monde indistinctement. Pour ça, il faudrait que l’homme cisgenre hétérosexuel soit un standard, et les autres profils, ses dérivés, des variables. Or, l’homme cisgenre hétérosexuel n’est qu’un profil parmi les autres. Si l’on vient à peine de commencer à adapter l’offre en fonction des revendications féministes, tout (ou presque) reste encore à penser et à faire pour le public LGBTQIA+, dont le nombre et les besoins sont largement sous-estimés. On ne peut pas continuer d’attendre que les personnes LGBTQIA+ se signalent, quand leur intégrité et leur survie dépendent directement de leur discrétion. Cette passivité relève au mieux du non-sens, ou au pire de ce qu’on appelle en anglais la weaponised incompetence, qu’on peut traduire par «incompétence stratégique », ou le fait d’« éviter ou de refuser d’accomplir une tâche et [d’] utiliser son « incompétence » comme excuse pour se soustraire à ses responsabilités. » (Cleveland Clinic, 2024, ma traduction)
La notion de responsabilité est ici fondamentale, puisque la Belgique comme la France ont ratifié la Déclaration Universelle des Droits Humains, qui stipule notamment que « toute personne, en tant que membre de la société » a droit « à la sécurité sociale ; […] fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité […] » (Nations Unis, s. d.) Puisque ce droit, comme tant d’autres, n’est pas effectivement garanti à tout le monde, le travail social est à ce titre un outil démocratique, qui vise à faire recouvrir ses droits à celles et ceux qui en sont dépourvu·es, et ce peu importe la raison. De plus, les associations du secteur, en France et en Belgique, réalisent un travail sans mandat direct de l’État, bien qu’elles soient largement subsidiées par des fonds publics16.
On peut donc parler d’une forme de sous-traitance des devoirs de l’État vers des acteurs et actrices privé·es, rassemblé·es en associations de droit commun. Ce que cela veut dire, c’est que l’État passe par le financement de ces associations à but social pour remplir son devoir démocratique de protection des personnes vivant à l’intérieur de ses frontières. Ce qui fait des associations en question des extensions des institutions publiques. Leur dysfonctionnement ou leur réticence plus ou moins affirmée à faire évoluer leurs pratiques relèvent donc, aussi et avant tout, de la responsabilité étatique. L’absence de réaction institutionnelle s’apparente alors, de fait, à un déni de droit, et donc à une action anti-démocratique.
La seule solution, face à ce constat, est de toute évidence de s’intéresser réellement à la question du sans-abrisme « féminin » et des personnes LGBTQIA+, d’allouer des moyens nécessaires à une recherche poussée et à la concrétisation des recommandations qui en sortiraient.
C’est la seule façon de rétablir l’ordre démocratique. Les droits sociaux ne peuvent pas attendre. Les gens ne peuvent pas attendre.
CONCLUSION
Pour conclure, on peut rappeler que l’invisibilité ne peut jamais être interprétée comme une absence. Au contraire, celle-ci procède bien souvent d’une vision trop standardisée, qui repousse dans les marges tout ce qui n’y correspond pas ou pas assez. Si le travail social envers les personnes sans chez-soi est indispensable, alors il l’est pour tout le monde, inconditionnellement. Cette inconditionnalité, paradoxalement, requiert une conditionnalité d’accueil. Non, on ne peut pas tout faire en même temps, c’est exact. Toutes les associations ne peuvent pas accueillir tous les publics. Mais ça ne peut jamais être une excuse derrière laquelle se réfugier pour faire l’économie d’une remise en question structurelle de ce que l’on propose, et pourquoi.
L’accueil dit inconditionnel17, aujourd’hui, est un accueil tout à fait conditionnel, pour hommes adultes (se faisant passer pour) hétérosexuels. Il faut continuer dans cette voie conditionnelle, pour qu’il y ait, en suffisance, des lieux et des services adaptés à chaque personne, chaque profil, chaque situation. Il ne s’agit même pas de faire du cas par cas, mais simplement de reconnaître, en actes et plus seulement en mots, la diversité de notre société occidentale actuelle, et de la servir au mieux dans tous les aspects possibles, y compris dans la très grande précarité.
Malheureusement, la situation tend à évoluer dans le sens d’un accroissement de la pauvreté. Il est de plus en plus difficile de trouver un emploi stable, de se loger, de subvenir à ses besoins.
Les risques augmentent davantage pour les personnes sujettes à la discrimination, et de plus en plus au fur et à mesure que les facteurs d’oppression systémique s’accumulent.
L’intersectionnalité des caractéristiques identitaires minorisées est largement théorisée, ses conséquences sur la vie des personnes sont amplement documentées. Au travail social de prendre les mesures nécessaires pour réduire les inégalités entre les personnes, puisque c’est exactement ce qu’il prétend faire.
BIBLIOGRAPHIE
ABRI : définition de ABRI. (s. d.). https://www.cnrtl.fr/definition/abri
Bachir, Hafida (2018) La pauvreté touche de la même façon les hommes et les femmes. Dans Pauvrophobie (p. 119). Éditions Luc Pire. https://www.pauvrophobie.be/index.php/home/pauvrophobie-le-projet/
Carpentier, Josse. (2023). Les atteintes anti LGBT enregistrées par les forces de sécurité augmentent légèrement en 2022. Dans Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieur, Infos Rapides N°25. (Consulté le 5 août 2024,) https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/134610/1067097/file/IIR25.pdf
Cleveland Clinic. (19 août 2024). How weaponized incompetence can hurt your relationships. (Consulté le 21 août 2024) https://health.clevelandclinic.org/weaponized-incompetence
Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8. http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
D’Ursel, Laurent. (2023). Dix-sept mots pour en finir avec le sans-chez-soirisme. Action et Recherche Culturelles. https://www.arc-culture.be/publications/17-mots-pour-en-finir-avec-le-sans-chez-soirisme/
Dagorn, Johanna. (25 novembre 2021). La majorité des violences faites aux femmes ont lieu au sein des foyers. Slate.fr. https://www.slate.fr/story/219648/femmes-violences-conjugales-plus-frequentes-espaces-prives-foyers
Dismantling An Epidemic of Violence. (s. d.). HRC Digital Reports. https://tinyurl.com/yv7zn39t
Dupont, Anne-Sophie. (2022). La crise du logement à Bruxelles : la comprendre et en sortir.
RBDH-BBRoW. http://rbdh-bbrow.be/analyses/
Elver, David. (15 juin 2024). Besoins en matière de logement et enjeux des personnes 2SLGBTQIA+. SCHL. (Consulté le 13 août 2024) https://www.cmhc-schl.gc.ca/lobservateur-du-logement/2022/personnes-2slgbtqia-et-besoins-en-matiere-de-logement
Enquête # YouToo ? (2020). Institut Pour L’égalité des Femmes et des Hommes. (Consulté le 5 août 2024 (https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/discrimination/sexisme/enquete_youtoo)
Enquête sur l’accès aux droits – volume 5 – Les discriminations dans l’accès au logement
Défenseur des Droits. (14 décembre 2017). Défenseur des Droits. (Consulté le 14 août 2024) https://www.defenseurdesdroits.fr/enquete-sur-lacces-aux-droits-volume-5-les-discriminations-dans-lacces-au-logement-452
FEANTSA. (2007). ETHOS – Typologie européenne de l’exclusion liée au logement.
https://www.feantsa.org/fr/resource/toolkit/2012/07/12/ethos-typologie-europeenne-de-l-exclusion-liee-au-logement?bcParent=27
Gosselin, Isabelle. (2021). Queeriser l’hôpital public ? La clinique SOGIE : une clinique mineure au CHU [Mémoire de maîtrise, Université catholique de Louvain]. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=thesis%3A29891&datastream=PDF_01&cover=cover-mem
Hachem-Samii, Yahyâ. (2018) Les sans-abri ont décidé de vivre dans la rue, c’est un choix.Dans Pauvrophobie (p. 378). Éditions Luc Pire. https://www.pauvrophobie.be/index.php/home/pauvrophobie-le-projet/
Haut Conseil du Travail Social. (2017). Définition du travail social. (Consulté le 24 août 2024)
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/definition_du_travail_social-2.pdf
Housing in Europe – 2023 Edition – Eurostat. (2023). Eurostat.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/housing-2023#is-housing-affordable
Jeunes LGBTIQ sans-abri : comment mieux prendre en compte ce public ? – Fédération des acteurs de la solidarité. (7 décembre 2020). Fédération des Acteurs de la Solidarité. (Consulté le 13 août 2024) https://www.federationsolidarite.org/actualites/jeunes-lgbtiq-sans-abri-comment-mieux-prendre-en-compte-ce-public/
Jourdan, Nadine., Timoteo, Joachim., & Rastit, Françoise. (2010). Les femmes sont davantage confrontées à la pauvreté. Les facteurs à l’origine de cette disparité. INSEE. (Consulté le 5 août 2024) https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1292476/ana02.pdf
Kimberlé Crenshaw, la juriste qui a inventé « l’intersectionnalité » . (9 janvier 2019). Le Nouvel Obs. https://www.nouvelobs.com/idees/20190109.OBS8245/kimberle-crenshaw-la-juriste-qui-a-invente-l-intersectionnalite.html
L’Ilot. (2022). Sans-abrisme au féminin : sortir de l’invisibilité. calameo.com. https://www.calameo.com/books/0066237050a5b904e4e13 Le Centre de jour pour pour femmes sans abri Circé de L’Ilot. (24 juin 2024). L’Ilot. https://ilot.be/circe/
Lieber, Marylène. (2002). Le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public : une entrave à la citoyenneté ? Nouvelles Questions Féministes, 21, 41-56. https://doi.org/10.3917/nqf.211.0041
Lieber, Marylène. (2008). Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question. Les Presses de Sciences Po, coll. 324 p. https://journals.openedition.org/lectures/2164
Maurin, Louis. (27 octobre 2023). Le nombre de crimes et délits anti-LGBT en hausse par rapport à 2016. Observatoire des Inégalités. https://inegalites.fr/nombre-crimes-delits-anti-LGBT
Mérentié, Francesca. (16 février 2023). La « misogynoire » , une discrimination méconnue qui touche les femmes noires. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954570/misogynoir-femmes-noires-afrodescendantes-racisme-sexisme-micro-agressions
Mormont, Marinette. (6 février 2023). Du sofa à la rue : le sans-abrisme caché des LGBT. Alter Echos. (Consulté le 13 août 2024) https://www.alterechos.be/1016604920/
Nations Unies. (s. d.). Déclaration universelle des droits de l’homme | Nations Unies. (Consulté le 21 août 2024) https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Pourquoi les femmes sont plus exposées à la pauvreté | Caritas Suisse. (2022, août 4). Caritas Suisse. (Consulté le 6 août 2024) https://www.caritas.ch/fr/pourquoi-les-femmes-sont-plus-exposees-a-la-pauvrete/
Romainville, Alice & De Laet, Sarah. (2023, 31 juillet). Le logement social, une solution (presque) oubliée. Observatoire Belge des Inégalités. https://inegalites.be/Le-logement-social-une-solution
SANS-ABRI : définition de SANS-ABRI. (s. d.). https://www.cnrtl.fr/definition/sans-abri
Talpin, Julien., & Bonnevalle, Pierre. (2024). Autonomie associative et financements publics : une enquête localisée. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). (Consulté le 24 août 2024) https://idaf-asso.fr/wp-content/uploads/2024/05/Rapport-2024-07_Autonomie-asso-et-financement-public.pdf
The Trevor Project. (2022). Homelessness and housing instability among LGBTQ youth. (Consulté le 8 août 2024) https://www.thetrevorproject.org/research-briefs/homelessness-and-housing-instability-among-lgbtq-youth-feb-2022/
Warin, Philippe. (1 juin 2010). Qu’est-ce que le non-recours aux droits sociaux ? (Consulté le 21 août 2024) https://laviedesidees.fr/Qu-est-ce-que-le-non-recours-aux.html
- Cisgenre : qui n’est pas transgenre, qui s’identifie au genre qui lui a été assigné à la naissance ↩︎
- L’étude se concentre exclusivement sur les personnes trans, il n’y est donc pas question de toute la communauté LGBTQIA+. ↩︎
- L’enquête ayant été menée dans toute la Belgique, elle reprend aussi sans traduction des insultes et menaces proférées en flamand. Cette expression-ci se traduit en français par : « ça coûte combien ? » ↩︎
- Mot anglais utilisé comme une insulte homophobe qui peut se traduire en français par : « pédale » ↩︎
- Diminutif anglais de « lesbian » (lesbienne en français), à entendre ici comme une injure ↩︎
- Expression insultante en flamand, se traduisant en français par : « homme-femme » ↩︎
- Menace de mort en flamand, qui se traduit par : « Je vais faire un trou dans ta tête » ↩︎
- Itinérance est un terme utilisé en sciences sociales et dans les médias québécois. Il doit s’entendre comme un synonyme de « sans-abri » ou « sans-chez-soi ». ↩︎
- 2SLGBTQIA + : acronyme spécifique au contexte démographique canadien. Le « 2S » au début de l’acronyme signifie « two-spirited » (deux esprits), ce qui est une identité de genre revendiquée par les populations natives du pays comme étant inhérente à certaines de leurs cultures. ↩︎
- HLM est l’acronyme utilisé en France pour parler des logements sociaux. Il signifie « habitation à loyer modéré ». ↩︎
- https://www.talita.brussels/ ↩︎
- https://samusocial.be/missions-et-dispositifs/lhebergement/la-mission-sans-abri/les-dispositifs-dhebergement-durgence/centres-daccueil-durgence/ ↩︎
- https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/femmes-la-rue-ouverture-dune-maison-regionale-des-femmes-paris ↩︎
- https://www.bruzelle.be/fr/ ↩︎
- https://samusocial.be/centre-louiza-le-centre-pour-femmes-du-samusocial/ ↩︎
- Il faudrait ajouter que, en France et en Belgique, les financements de fonctionnement sont de plus en plus rares, laissant place à des « appels à projets » mettant en concurrence les associations candidates. C’est une forme de précarisation du secteur (et donc in fine du public qu’il cible) qui est discutée notamment dans le dernier rapport « Autonomie associative et financements publics : une enquête localisée » de Julien Talpin (CNRS) et Pierre Bonnevalle (CERAPS). ↩︎
- Il existe tout de même des associations et collectifs qui peuvent se révéler utiles pour les personnes issues des communautés LGBTQIA+ et ou travailleuses du sexe en difficulté. On peut notamment citer l’asbl Alias et UTSOPI à Bruxelles. Pour les addictions et assuétudes, Transit asbl et le Projet LAMA (services non réservés aux personnes issues des communautés LGBTQIA+). En cas de risque d’expulsion de son logement, il existe le Front Anti-Expulsions. Pour apprendre à ouvrir des bâtiments vides et occuper l’espace vacant : le Permanence Squat. ↩︎
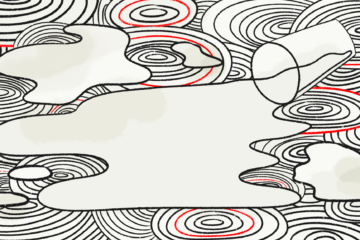


0 commentaire