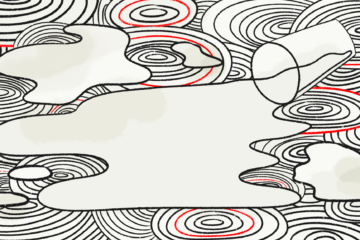Quand la fiction sert d’alibi : Bastien Vivès et le refus de penser la représentation
Le dessinateur Bastien Vivès est accusé par la justice française de représenter de manière problématique des violences sexuelles sur mineur·es dans plusieurs de ses BD. Le discours médiatique (notamment dans Le Monde) autour de ce sujet a tendance à inverser les rôles en présentant l’auteur comme victime, à disqualifier les critiques en les accusant de confusion entre fiction et réalité, et à instrumentaliser la liberté d’expression pour protéger un ordre culturel établi. Cette analyse souligne que la fiction n’est jamais neutre : elle participe en effet à la construction du réel et ne saurait servir d’alibi pour éviter toute responsabilité éthique ou politique.