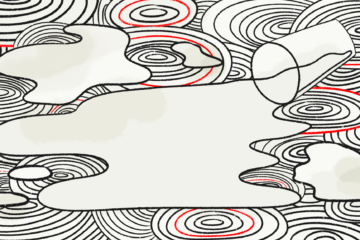Travail mémoriel des femmes* : entre aliénation et résistances
La mémoire n’est ni innée ni neutre : elle est une compétence qui s’apprend, se cultive et se transmet, bien souvent de mère en fille. À ce titre, elle recèle un potentiel profondément féministe. Quels récits, quelles normes et quelles résistances circulent à travers ces transmissions ? Et comment penser la mémoire autrement, à partir de perspectives queer et décoloniales, pour transformer notre rapport au temps, aux autres et au vivant ?